Cette page est une copie très imparfaite venant d'un site qui a disparu (www.reveursdepoles.com)
extrait du livre Résistez! d'Emmanuel Hussenet voyageur depuis plus de vingt ans dans l'Arctique
La France profonde, vous connaissez ?
Dépêchez-vous de vous y rendre et d’y respirer la profondeur, comme un parfum
voué à une irréversible évaporation. Ici, la profondeur, on la perce et on la
vide de sa substance. Le territoire perd à tout jamais ce qui lui restait
d’incertain et de particulier pour devenir une marchandise comme une autre. La
campagne se mue en une vaste banlieue de villégiature, planifiée par un modèle
unique et quadrillée par un réseau linéaire. Hâtez-vous de la trouver là
encore où l’autoroute ne l’a pas livrée au tout-venant. À force de
« désenclavement », la France profonde devient superficielle.
En guise d’exposition
Qui
d’entre nous n’a pas trouvé son jardin secret ou bord du ruisseau, entre deux
vergers jouxtant l’ancienne maison forestière, près du rocher d’où pouvait
être admirée toute la vallée ? Et qui, un mauvais jour, n’a pas été blessé au
plus profond de son âme en constatant le peu de poids d’un jardin secret face
à celui d’un arrêté ministériel ?
Des dizaines de milliers de personnes qui peuvent se déplacer plus rapidement
méritent sans doute davantage de considération que quelques familles
expropriées ou une poignée de promeneurs au romantisme en inadéquation avec
leur époque. Les uns gagnent par le nombre et par la vitesse, les autres
échouent de par leur rareté et l’insolvabilité de leurs sentiments. Le
ruisseau coulait sans grande utilité, les vergers ne produisaient que des
pommes, la maison forestière n’abritait qu’un petit club de poneys, et la
longue vallée ne laissait monter que le bruissement des frondaisons mêlé au
son des cloches. Tout cela ne représentait rien, puisque l’intérêt public n’a
même pas cherché à rendre hommage à ce qu’il détruisait. Qu’on réclame ici une
autoroute, et le progrès se chargera de la construire. Elle s’imposera comme
une réalité évidente, incontournable, modèle de développement pour des gens
qui ne feront que se croiser encore plus vite. Mais le progrès est triste. Il
retire aux choses simples la joie naturelle qu’elles contiennent. Il substitue
le bruit à la présence.
Encore
une fois, c’est le monde rural qui trinque. Le « désenclavement » n’est qu’un
prétexte qui facilite la fuite des populations et l’arrivée des touristes de
tout poil. Les autoroutes n’ont jamais été construites pour la campagne, mais
toujours pour relier une ville à une autre, la campagne étant là une fois de
plus pour supporter les lubies citadines. Il en va de même des lignes de train
à grande vitesse qui balafrent les terres sans avoir cure de tout le mal que
leur passage peut provoquer, car ces trains sont construits pour servir des
intérêts qui dépassent bien largement ceux des communes traversées. On est
loin des michelines qui s’occupaient patiemment à desservir les bourgs, au
service de la population à laquelle elles rendaient visite.
Bien
sûr, les temps ont changé. Mais gare à ces changements pré-programmés, qui
s’appuient sur le constat du moment pour imaginer que l’avenir ira toujours
dans le même sens, et qu’il faut l’anticiper en construisant toujours
davantage. Bon nombre d’autoroutes ne correspondent pas à de véritables
besoins ou, pire, elles les créent. Besoin nouveau d’aller toujours plus loin
par incapacité à appréhender ce qui est proche. Besoin d’acheminer plus vite
dans le midi de la France des chips de marque fabriquées dans le Nord,
de crainte de perdre un marché. Besoin de faire circuler le plus grand nombre
possible de choses inutiles pour brûler encore plus de pétrole.
À tous ces besoins d’utilité publique – ou d’utilité politique –, à cet appel
collégial en faveur de la réduction des délais et de la relance de l’économie
répond la voix ténue de la personne. Personne isolée qui mesure avec
inquiétude tout ce qui se trame autour d’elle, au nom d’intérêts dont aucun ne
figure parmi ceux, plus simples et certainement moins progressistes, qui lui
font préférer un petit coin de campagne à une voie à grande vitesse.
* * *
Les
combats contre les grands travaux qui se rattachent aux transports sont parmi
les plus difficiles. Devant ces projets d’envergure nationale, l’opinion des
riverains est d’un bien faible poids. Construire une autoroute, une ligne de
train à grande vitesse ou un aéroport ne relève pas de la préfecture, mais du
ministre des Transports, du Premier ministre et du Conseil d’État. La
déclaration d’utilité publique est de rigueur. Dès l’instant où le Conseil
d’État autorise les travaux, il devient impossible d’engager quelque recours
légal que ce soit. Le citoyen n’a donc par définition pas voix au chapitre,
même si la Commission nationale du débat public s’applique à sauver les
apparences.
Après
force combats, il est parfois possible de repousser les échéances, de faire
passer l’autoroute 500 mètres plus loin ou d’obtenir un crapauduc, mais le
projet en lui‑même ne pourra être remis en question que si un ministre change
d’avis, ou si les finances ne suivent pas. L’intérêt public se décide à
l’écart du public. C’est une réalité parfois difficile à admettre, mais elle
est sans doute une condition nécessaire pour gouverner. Un projet
d’installation classée oppose le public à l’entrepreneur, et c’est à l’État de
trancher. L’État, qui joue alors un rôle de médiateur et de juge, peut dans
certains cas être un allié des citoyens. Pour une autoroute, le public
s’oppose directement à l’État. Il n’y a plus de recours, plus de médiateur ni
juge. Ni allié.
Ce
chapitre abordera essentiellement le cas des autoroutes, sachant que les
lignes de TGV imposent des contraintes du même ordre et que les adversaires
sont à peu près identiques. Les autoroutes sont généralement plus contestées
que le rail, dans la forme et dans le fond, parce qu’elles sont plus
nombreuses et ont un impact supérieur aux lignes de TGV. Ces dernières sont
cependant loin d’être inoffensives, des associations d’expropriés se sont
créées sur leur passage, et beaucoup de riverains estiment leur vallée
défigurée par le passage d’un viaduc monumental construit soit pour gagner
trente secondes de trajet, soit pour offrir une jolie vue au client étranger.
Le
fait est que, compte tenu de l’époque que nous traversons, un certain nombre
d’autoroutes étaient indispensables à construire. Il n’est pas dans le propos
de ce chapitre de remettre en cause des choix nationaux et économiques
fondamentaux, mais de s’intéresser à celles et ceux qui en ont assez de faire
les frais d’une politique des transports qui aujourd’hui n’apparaît plus aussi
fondée qu’elle a pu l’être il y a une vingtaine d’années. À présent que les
principaux axes sont équipés, est-il encore pertinent de vouloir toujours
plus ? Une association d’opposants parle de « frénésie autoroutière » et le
terme semble assez juste : ce n’est pas l’autoroute qui est remise en
question, mais l’excès d’autoroutes, encore présentées par leurs promoteurs
comme la réponse universelle aux enjeux contemporains. Au train où vont les
choses, conformément aux vœux de plusieurs ministres des Transports, aucun
français ne sera éloigné de plus de 50 kilomètres d’une entrée d’autoroute. La
question est de savoir si le sacrifice systématique de la campagne au nom d’un
« développement » dont elle se passerait bien est réellement nécessaire, et si
l’on ne peut pas souhaiter d’autre perspective pour l’avenir que la croissance
des nuisances routières et le bétonnage systématique.
Il
paraît inutile de décrire le fonctionnement d’une autoroute comme nous l’avons
fait pour l’élevage industriel, l’énergie éolienne ou l’épandage des boues
d’épuration. Une autoroute est construite à l’usage du grand public : tout le
monde connaît. C’est une bande de bitume un peu aménagée avec une aire de
services tous les 40 kilomètres. On prend un ticket à l’entrée et on tend sa
carte bleue à la sortie.
Concentrons-nous alors sur quelques-unes des nombreuses levées de bouclier
générées par la politique des transports autoroutiers. Plusieurs cas seront
abordés pour tenter d’appréhender au mieux la diversité des combats engagés.
Au préalable, cependant, faisons le tour de ce qu’il paraît utile de savoir.
Le « nimby »
Cet anglicisme désigne l’attitude consistant à refuser une agression de
l’environnement sur le principe de l’atteinte à ses intérêts particuliers.
L’abréviation de Not In My Backyard (pas dans mon arrière-cour),
répandue en France par les milieux écologistes anglo-saxons, s’en prend aux
riverains qui agissent avec un esprit de clocher et revendiquent le seul
déplacement des projets. Les écologistes, à la vision des choses évidemment
plus globale, exercent un jugement souvent critique sur ce comportement, et
se donnent pour mission, par l’information, de le faire évoluer vers un
engagement de fond.
Or, le « nimby » est-il une tare ? Un village ne résistera à l’implantation
d’une infrastructure industrielle que s’il fonde sa défense sur un refus
unanime, unanimité généralement obtenue sur le thème du « pas chez nous ».
C’est la pression populaire qui fait céder les pouvoirs publics, et non le
discours écologiste insuffisamment partagé. Le « nimby » est dans ce cas la
première force sur laquelle peut s’établir une contestation rurale. En
outre, la plupart des leaders des associations actives ont compris
l’importance de passer d’un problème particulier à un engagement général, la
réaction individualiste n’étant en définitive que le phénomène déclencheur
qui précède la prise de conscience.
Il reste bien sûr des cas où le « nimby », s’il ne dépasse pas le stade
primaire, se révèle désastreux pour l’action collective. Par rapport à une
autoroute, par exemple, le riverain militant risque d’oublier, attendri par
les arguments du maître d’ouvrage, que c’est à l’autoroute elle-même qu’il
en veut, et d’accepter de retourner chez lui contre la promesse d’une buse
de drainage ou d’un talus antibruit. À un autre niveau, on a vu le
propriétaire d’un château ligérien, pour éviter de voir son domaine écorné
par l’autoroute, engager un recours auprès de la Cour de justice européenne,
et se retrouver partie perdante. Cette malheureuse initiative aura pour
conséquence de créer une jurisprudence qui entraînera l’échec d’autres
affaires conduites cette fois par des associations.
Les Mosellans et le débat public
La Lorraine est loin d’être la zone
sinistrée que beaucoup imaginent, réduisant cette vaste région aux seules
houillères. La vallée de la Moselle qui accueille les deux capitales
régionales, Metz et Nancy, est économiquement très active. La Lorraine
mosellane est un bassin d’activités long de 80 kilomètres, dont le dynamisme
et la prospérité n’a rien à envier aux autres métropoles régionales. Et,
rançon de l’expansion économique, l’autoroute A 31 (gratuite) qui dessert
l’ensemble de la vallée, de Toul à la frontière luxembourgeoise, souffre d’un
engorgement tel qu’il conviendrait de lui créer une sœur jumelle, l’A 32
(payante).
L’idée de dédoubler l’autoroute paraît
séduisante pour ceux qui pensent qu’il faut impérativement dégager l’axe
international du surnombre de ses poids lourds et véhicules particuliers. Mais
la solution, aussi efficace pourrait-elle être, se révèle impopulaire,
contrairement à d’autres autoroutes « attendues depuis des lustres » et dont
la mission est de sortir les ruraux de « l’exclusion économique ». La Moselle,
voie de passage des peuples du Nord vers le Sud depuis des siècles, n’a jamais
manqué d’infrastructures liées au transport, et désormais la population dit
clairement « stop ! » Vingt-trois parlementaires ont pris l’initiative de
saisir la Commission nationale du débat public (CNDP) sur la question. Voici,
extraits des conclusions publiées en 1999, les principaux arguments qui se
sont dégagés au cours de ce débat public.
Rappels concernant le débat public
La déclaration d’utilité publique n’a pas pour fonction de consulter le
public, mais d’acter publiquement de l’utilité publique d’un projet pour
permettre les expropriations. L’utilité collective d’un ouvrage se décide
avant toute consultation du public. Depuis 1995, il peut y avoir une
exception à cette règle lorsque la Commission nationale du débat public est
saisie. La CNDP a pour mission d’engager la concertation sur les grands
projets dès leur conception, de manière à répondre aux revendications de
plus en plus pressantes des associations et des citoyens en matière de
démocratie participative.
Lorsqu’un débat est engagé, la commission particulière du débat public
(CPDP) utilise de nombreux moyens pour le faire savoir (imprimés,
communication via Internet, cartes-réponses, expositions, réunions publiques
et thématiques, forum, etc.). Il existe cependant un décalage entre les
attentes du public et les pratiques effectives. La CPDP reconnaît ses
difficultés à organiser le dialogue dans le contexte des réunions publiques,
« qui se prêtent mieux aux prises de position de principe et à
l’affrontement qu’à la discussion ». De plus, les maîtres d’ouvrage et
certains institutionnels ne sont manifestement pas en attente de l’opinion
populaire, et préfèrent se limiter à une simple information destinée à
améliorer l’acceptabilité du projet. La décision finale devra être approuvée
par le Conseil d’État qui fera la part des choses entre l’avis du public et
l’intérêt général. En application de la « théorie du bilan », c’est l’enjeu
estimé le plus important qui l’emportera.
Plus de 9 000 Lorrains ont
émis des réflexions dans le cadre du débat public sur le projet d’autoroute
A 32. Ces avis ont fait ressortir le fait que chacun avait bien conscience des
problèmes soulevés par la saturation à certaines heures de l’autoroute A 31,
mais surtout, que la solution consistant à construire une seconde autoroute
était loin d’être la bienvenue. Débats et courriers ont montré que les gens
cherchaient à trouver des solutions aux problèmes posés par l’A 31 sur la
perspective de développement du ferroutage, plus que sur le projet d’autoroute
A 32 lui-même.
L’opposition à la
construction d’une nouvelle autoroute :
L’opposition s’est très
largement fait entendre tout au long du débat. Elle s’appuie, d’une part, sur
un refus de principe de l’autoroute, lié à un choix de société et à la
revendication d’une certaine qualité de vie, et d’autre part, sur la remise en
cause de l’utilité d’un tel projet pour le développement régional. Ces
positions sont à la fois celles des associations environnementalistes et des
riverains, tous dénonçant la solution du bitumage. L’accent est mis sur les
effets des constructions autoroutières en termes de nuisances sonores, de
dangers pour la préservation des sites naturels ou classés, ou de dégradation
des paysages. La pollution engendrée par la circulation est également un
argument qui revient souvent, abordé tant sous l’angle de ses conséquences
écologiques (effet de serre) que de ses effets sur la santé. En outre, la
question de la sécurité sur route a aussi été présentée comme un argument
jouant en faveur de la recherche d’autres moyens de transport, en particulier
dans cette zone qui connaît un fort trafic de transit de poids lourds. Enfin,
les incidences du développement autoroutier sur l’organisation de l’espace et
de l’habitat complètent ces arguments : les autoroutes favorisent l’extension
des zones périurbaines, au détriment des centres-ville, et incitent les
habitants à utiliser de plus en plus leur voiture. Ces nouveaux besoins ainsi
créés suppriment tout espoir de voir un jour se réduire la circulation
routière.
Aux arguments du maître
d’ouvrage concernant l’importance de cette nouvelle infrastructure pour le
développement économique de la Lorraine, les habitants ont répondu par un vif
scepticisme, conscients que l’A 32 ne serait avant tout qu’un itinéraire de
délestage pour le transit international. En revanche, les habitants des
communes extérieures au « sillon mosellan », et donc en retrait du tracé de
l’A 32, paraissent davantage convaincus de l’apport économique et souhaitent
en bénéficier. Quelques grands élus et les rares représentants du monde
économique qui ont participé au débat sont également intervenus pour dire la
nécessité d’une nouvelle autoroute en vue de satisfaire aux besoins des
entreprises.
Au-delà de la défense de
son environnement personnel, les opposants au tracé se sont aussi appuyés
sur le souhait de voir l’autoroute sortir du sillon mosellan, de manière que
des communes plus excentrées puissent en bénéficier. L’argument de l’impact
économique avancé par les services de l’État se révèle plus percutant auprès
des communes qui se sentent géographiquement défavorisées qu’auprès de celles
qui ont déjà l’expérience de l’autoroute.
De nombreuses propositions
ont été faites pour l’aménagement de l’A 31 (mise à 2 X 3 voies) ou
l’amélioration du réseau routier déjà en place sur le territoire lorrain.
Puis, face à une forte demande de développement du ferroviaire, la Commission
a organisé une réunion thématique supplémentaire, entièrement consacrée au
ferroutage et au transport combiné. Le transport fluvial a également fait
l’objet de discussions. Le développement de l’intermodalité (route, fer,
fluvial) fut l’un des thèmes récurrents des débats et des différentes
contributions remises à la Commission. Naturellement, si on peut estimer que
la commission particulière s’est intéressée sincèrement à l’opinion des
administrés et à leur rêve de voir des camions sur des rails, la CNDP, et
surtout l’État qui en a le contrôle, avait sans doute mieux à faire que de
prêter attention à ces bavardages.
Issue à double sens :
À la suite des conclusions
dressées par la CPDT, le projet d’autoroute A 32 a été annulé. « Voilà une
preuve du bon fonctionnement de la démocratie ! » serait-on tenté de se dire.
Certes, il y a eu débat public, et malgré quelques critiques, tout s’est
globalement bien passé. De plus, les Mosellans ont obtenu l’annulation qu’ils
appelaient de leurs vœux ; événement tellement rare qu’il en est suspect, et
que l’on peut se demander si cette consultation ne relevait pas de la mise en
scène.
L’objectif consistant à
doubler une autoroute gratuite par une autoroute payante avait déjà de quoi
surprendre. Comment rendre une telle infrastructure commercialement
défendable ? Comment croire que les camions étrangers, les premiers qu’on
aurait préféré voir passer ailleurs, choisiront l’autoroute payante plutôt que
celle qui resterait gratuite ? Ensuite, il paraît assez étrange que le tracé
de cette seconde autoroute restât cantonné au sillon mosellan, là où se
concentre l’urbanisme et où il était joué d’avance qu’aucun riverain
n’apprécierait de sacrifier son petit carré de verdure pour permettre à des
poids lourds hollandais ou espagnols de rouler plus vite. L’expérience montre
que les « vrais » projets autoroutiers, c’est‑à‑dire ceux que l’État souhaite
réellement faire aboutir, choisissent en priorité les zones de délaissement
agricole, les lisières de forêts, les campagnes vides où les risques de
rencontrer une résistance – riverains ou syndicats agricoles – seront les plus
ténus. Pourquoi, dans ce cas précis, a-t-on préféré se jeter dans la gueule du
loup ?
Ce projet ne s’inscrivait pas
dans la politique nationale de maillage autoroutier. L’idée avait été lancée
par des élus locaux qui ont sollicité un maître d’ouvrage pour mettre en place
l’avant-projet. L’A 32 était soutenue par des personnalités trop éloignées de
l’État, qui de son côté ne trouvait aucun avantage particulier à ce qu’elle se
construise. On peut imaginer que plutôt que de demander aux élus lorrains de
revoir leur copie, le gouvernement a profité de l’opportunité de ce projet
d’importance secondaire et dont il ne voulait probablement pas lui-même, pour
engager un débat public. Ainsi, puisque l’issue du débat avait toutes les
chances d’être défavorable, le Conseil d’État pouvait s’offrir le luxe de
calquer son verdict sur celui des citoyens. Il est probable que dans ce cas
particulier, tout était une fois de plus joué d’avance, mais à la défaveur du
maître d’ouvrage, des chambres de commerce et des conseillers généraux. Il
faut bien donner de temps en temps au peuple l’impression qu’il peut gagner.
Le verdict de la Cour des comptes
Depuis 1991, la Cour des comptes publie des rapports particuliers sur les
politiques publiques. Dans ce cadre, la Cour des comptes a examiné les comptes
et la gestion de huit sociétés concessionnaires, de deux associations, de deux
établissements publics et du service d’études techniques des routes et
autoroutes. Son rapport sur la politique routière et autoroutière, publié
en 1999, passe en revue les caractéristiques du système autoroutier français,
les conditions de choix relatives aux investissements et l’impact des
équipements sur la situation économique et l’environnement. Elle affirme que
« les conséquences des choix autoroutiers sur l’emploi et l’aménagement du
territoire ont été moins favorables que prévu, alors que leurs incidences sur
l’environnement ont longtemps été sous-évaluées […], les projets autoroutiers
semblent répondre plus à des préoccupations de maillage géométrique qu’à une
rationalité économique et sociale ».
Le bilan
n’est pas tendre. Élus locaux, parlementaires, conseillers d’État, ministres
de droite comme de gauche sont sévèrement dénoncés pour leurs propos
contraires à l’intérêt public réel et aux lourdes conséquences pour
l’environnement et pour la société. Le rapport, loin de se limiter à une
analyse des comptes des sociétés d’autoroutes, constate les impacts de ces
infrastructures sur le milieu rural en confirmant le leitmotiv des
associations : la rançon du « désenclavement », c’est une campagne qui se vide
plus rapidement, des emplois retirés aux petites communes pour être reportés
sur les aires de services, un tissu rural déchiré, une hausse anormale des
prix de l’immobilier dans les régions touristiques. La Cour observe que
l’autoroute n’a absolument pas enrayé le déclin de certaines commune de
moyenne importance (cas d’Avallon ou de Brioude), alors que d’autres villes
relativement mal desservies, pour ne pas dire « enclavées », ont connu un net
rebondissement démographique et économique (Ganges-Le Vigan ou Cholet). De
surcroît, les entreprises qui travaillent sur le réseau autoroutier
travaillent sur un marché régional ou national, et les entreprises locales
sont très peu sollicitées.
« Les autoroutes accélèrent les déséquilibres territoriaux et accentuent la
polarisation du territoire », affirme la Cour des comptes, qui rappelle
aussi que « contrairement aux principes de la LOTI (loi d’orientation
sur les transports intérieurs), les schémas directeurs routiers successifs
n’ont été qu’une réponse empirique aux demandes des élus ». En conséquence
de quoi, les sociétés d’autoroutes se sont massivement endettées ; endettement
qui s’accroît dans des proportions inquiétantes, puisque qu’aucune autoroute
actuellement en construction ne promet d’être rentable.
La
Cour des comptes dénonce :
Des
bureaux d’études non indépendants : les services techniques du ministère de
l’Équipement, incapables de mener seuls toutes les études nécessaires, ont
recours à la sous-traitance. Or, les bureaux d’études retenus ne sont pas
indépendants, ils sont liés aux sociétés autoroutières ou à l’industrie des
travaux publics. Ces bureaux seront en outre chargés de prévoir le trafic à
l’horizon 2015, en vue de réviser le schéma directeur routier national.
Prévisions dont il n’est pas difficile, dans ces conditions, d’imaginer la
tendance.
Des
estimations faussées : le résultat de cette entente entre le maître d’ouvrage
et les bureaux d’études se retrouve dans les chiffres, modulables en fonction
du but recherché : « les paramètres et évaluations retenus pour le calcul des
avantages des projets semblent sur bien des points contestables, cependant que
leurs coûts se révèlent sous-estimés ». Dans la réalité, selon le rapport de
la Cour des comptes, le dépassement des coûts atteint jusqu’à + 115 % pour
l’A 29 et l’A 131, et + 168 % pour l’A 64 ! La sous-estimation des coûts
permet de camoufler le déficit économique et d’obtenir la confiance des élus
qui se prononceront au vu de ces études. À l’inverse, les trafics et les
retombées socio-économiques sont surestimés.
Des études d’impact sur l’environnement tronquées : les études ne portent que
sur les tracés et ignorent les conséquences sur l’environnement des
extractions de matériaux et des remembrements, souvent bien supérieures à
celles de l’infrastructure en elle-même.
Le
morcellement des projets : les sociétés d’autoroutes utilisent fréquemment la
méthode consistant à lancer des travaux sur une portion réduite avant les
résultats de l’étude d’impact ou de l’enquête de faisabilité. Une fois que
l’autoroute est commencée, il devient alors beaucoup plus difficile de la
réfuter. La Cour déplore également l’absence de concertation et critique
vivement le Conseil d’État pour ses rejets de requêtes associatives pourtant
fondées.
A lire :
Rapport
particulier de la Cour des comptes
La politique autoroutière française
Éditions des Journaux officiels
Juin 1999 - Prix : 18,90 euros
Sachez vous
défendre !
Le Comité contre la frénésie
autoroutière, créé en Indre‑et‑Loire par Eric Burmann, est connu comme étant
l’un des mouvements antiautoroutes les plus radicaux. Le mot d’ordre est
simple : refus catégorique de toute concertation. Eric Burmann s’explique en
mettant au jour les manœuvres des promoteurs et de leurs épigones chargés de
désamorcer par tous les moyens la résistance avant même qu’elle ne se
manifeste.
Il existe des techniques très
élaborées pour éviter les mesures d’expropriation au cas par cas, qui sont
toujours longues, coûteuses et génératrices de conflits. Les partisans de
l’autoroute – chambre de commerce, SAFER, DRE, députés, conseillers généraux,
maires, préfet, etc. – sont mis à contribution pour préparer le terrain. Dans
le Loir‑et‑Cher, par exemple, un député a créé l’ADI, Association de défense
et d’information de l’autoroute A 85. L’ADI regroupe des communes ainsi que
d’autres associations formées par différents groupes proches de
l’entrepreneur. Ces associations sont chargées de convertir les riverains au
moyen de la « concertation », et de leur faire accepter le projet tel qu’il
leur est avantageusement présenté.
Parallèlement à cette action
« associative » sur les habitants, une autre organisation se charge de
convaincre les agriculteurs d’accepter les indemnités qui leur sont proposées.
Il s’agit de l’ADEA, Association des expropriés agricoles du Loir‑et‑Cher, qui
rassemble, sous l’égide de son président qui peut signer en leur nom, la
chambre d’agriculture, la fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles, le centre départemental des jeunes agriculteurs, le
Syndicat de la propriété agricole, le Syndicat des propriétaires fonciers et
la Fédération des syndicats agricoles. Tout ce petit monde se range derrière
l’ADEA qui a négocié avec COFIROUTE un accord portant sur les indemnités, et
se propose pour diffuser « l’information sur le contenu du protocole d’accord
destiné aux propriétaires et exploitants intéressés par le projet de
l’autoroute A 85 », de manière à « faciliter la libération en temps utiles des
terrains nécessaires à la construction de l’autoroute ».
Il est étonnant de constater
que dans ce département, tous les organismes agricoles, même les syndicats,
œuvrent dans le même sens, à travers une sorte d’union sacrée en faveur du
bitumage. Le propriétaire exploitant, lui, n’a plus qu’à accepter les
conditions qui lui sont proposées, ou plutôt imposées, puisqu’il ne participe
pas aux négociations. On imagine qu’un refus de sa part serait très mal
interprété.
« Aller le plus vite possible
dans la neutralisation ou l’acquisition des biens, et se prémunir des
procédures d’expropriation où les particuliers ont toutes les chances
d’obtenir mieux, casser la contestation par la « concertation », tels sont les
buts du concessionnaire et de l’armée d’associations et de syndicats qui
roulent pour lui, affirme Eric Burmann. Ces buts sont évidemment conçus à
l’avantage des tenants du projet, et non à l’avantage de la victime à qui on
veut faire croire qu’elle a intérêt à signer des accords amiables dans ce
cadre. […] Agriculteurs, viticulteurs, sylviculteurs, exploitants et
propriétaires, vos syndicats ne vous défendent pas ! Ils se sont mis au
service des constructeurs d’autoroutes, ils veulent leur faciliter la tâche,
trahir vos intérêts, vous dissuader de combattre le projet autoroutier. Ne les
laissez pas vous manipuler ! »
Refus total du projet,
refus de toute concertation !
Le Comité contre la frénésie
autoroutière développe, à l’attention des exploitants agricoles, un
argumentaire sans concessions pour les convaincre de ne pas signer. Cet
argumentaire, dont voici quelques extraits, permet de comprendre comment les
choses se jouent :
« Vous refusez de voir votre
patrimoine détruit, endommagé ou dévalorisé, de subir les préjudices
irrémédiables, non indemnisables et non compensables engendrés par l’autoroute
: plaie dans le paysage, bruit, gaz polluants, eaux polluées, chemins coupés,
perspectives bouchées, paysage dénaturé.
Ne tombez pas dans les pièges
qu’on vous tend :
pour vous faire croire que
tout est décidé,
qu’on ne peut pas revenir en
arrière,
que les travaux sont
imminents,
bref, pour obtenir de vous
que vous renonciez dès le départ à vos droits légitimes.
La désinformation, les faux
bruits sur les travaux qui commencent, sur les propriétaires qui auraient déjà
cédé, etc., tous ces mensonges sont destinés à désamorcer la protestation.
La réunion de concertation
est l’instrument le plus efficace pour vous rouler dans la farine : renoncez à
y assister !
Ces réunions de concertation,
ces groupes de travail tendent à transformer des opposants déterminés en
participants coopératifs, puis consentants. On peut alors tenter de vous
extorquer des accords préalables, tant sur la vente de vos biens que sur le
montant des indemnisations. Contrairement à tout ce qu’on vous raconte, ce
n’est jamais pour vous permettre d’obtenir les meilleurs dédommagements
possibles, mais pour vous soutirer un acquiescement préalable à des
contreparties minimales. Dans tous les cas, ne jamais rien signer. Il faut au
contraire obliger les représentants du camp adverse à mettre en œuvre, le cas
échéant, les procédures légales qui seules préserveraient vos moyens
juridiques de défense.
Ne pas oublier que, pour ce
qui concerne les biens immobiliers comme les maisons, bâtiments d’exploitation
et terres riverains du projet mais non expropriables, la dépréciation de
valeur serait considérable (entre 40 et 80 %), mais ne rentre pas dans la
catégorie des biens qui ouvrent droit à indemnisation.
Et souvenez-vous : ceux qui
vous manipulent savent ce qu’ils font. Ils le font délibérément, suivant les
directives d’une hiérarchie politique ouvertement malhonnête, au sens strict
du terme, agissant au nom des milieux affairistes les plus corrompus. »
Les Grézois ont
un truc
Texte de présentation de
l’association Non à la deuxième autoroute :
« Nous sommes en 2000
après Jésus‑Christ.
Toute la Gaule est envahie
par les autoroutes…
Toute ? Non !
Un village peuplé
d’irréductibles Grézois
résiste encore et toujours à
l’envahisseur.
Et la vie n’est pas facile
pour les garnisons
des camps retranchés comme
Prefectorum,
Conseil-Generalum et DDE(um)… »
Les habitants de Grèzes,
petit village de Lozère planté au pied d’un mamelon appelé « Truc », annoncent
la couleur. Autoroute, pas question. Projet hautement incompatible avec le
cadre champêtre et l’humeur des gens du cru. Et pourtant, que souhaiter de
mieux à ce département le moins peuplé de France, à l’agriculture pour le
moins extensive et à l’industrie quasi inexistante, qu’une belle autoroute
pour relier tout ça à la civilisation ?
Ce qui est intéressant à Grèzes, ce n’est pas la liste des arguments désormais connus auxquels les
opposants font référence pour s’opposer à la construction d’une nouvelle
infrastructure routière, mais l’état d’esprit dans lequel la lutte est
organisée. Résister, oui, mais en jouant plus d’un certain côté gouailleur,
genre rural insoumis et prêt à tout pour ne pas se laisser marcher sur les
pieds, que du volet écologique ou légal. D’ailleurs, en matière de légalité,
certaines actions des villageois eurent de quoi alarmer les services de prefectorum et DDEum…
Grèzes, dans cette Lozère où
la déperdition démographique s’expliquerait par le caractère renfermé des
indigènes, fait figure d’exception. Ici, 280 habitants suffirent pour obtenir
l’unique câblage du département, pour créer un centre d’astronomie amateur,
organiser des réunions philosophiques, proposer des festivités toute l’année,
réfléchir au développement de l’hôtellerie de plein air, à l’accueil de jeunes
artistes ou d’artisans, ou encore à la création d’un chemin de découverte de
la commune. Tous ces efforts survivraient-ils au passage de la « deuxième
autoroute », c’est‑à‑dire au dédoublement de la RN 88 sur l’axe Lyon-Toulouse
qui, au niveau de Grèzes, devrait ouvrir un nouveau tracé en 2 X 2 voies, afin
de rejoindre l’A 75 au moyen d’un viaduc monumental ?
Note : l’infrastructure en
question, baptisée « autoroute » par les opposants en raison de ses
caractéristiques autoroutières, est une 2 X 2‑voies non concédée. Le maître
d’ouvrage n’est donc pas une société d’autoroute, mais l’Équipement.
L’association Non à la
deuxième autoroute (la première autoroute est l’A 75, juste à côté) se crée
en 1993, dès que les habitants ont vent du projet. Intellos mais aussi
agriculteurs, purs Lozériens et « immigrés », l’association forme un véritable
patchwork des gens qui vivent en Lozère, avec l’équipe municipale au premier
rang. Solidaires des autres villages, les Grézois cherchent à remettre en
cause l’ensemble du projet. Leurs arguments sont :
le « bilan » : combien coûte
le projet par rapport au flux de voitures attendu ?
l’absence d’intérêt
économique pour la région
les problèmes liés à la
géologie, à l’aménagement du territoire (disparition attendue d’agriculteurs,
atteinte à l’argument numéro 1 de la Lozère : ses espaces naturels)
l’impact sur l’écologie
(faune, flore, en particulier la présence de chauves-souris d’intérêt
communautaire sur Grèzes)
le développement durable, et
la nécessité d’adapter le problème du transport aux décisions de Kyoto
Une résistance active et
mouvementée :
Au moment de la sortie de
l’avant-projet sommaire, l’association, qui a recruté tout le long du tracé,
compte déjà 1 000 adhérents, tandis qu’une pétition est signée par 98 % des
villageois. Le préfet, qui parle de la « dimension européenne de l’axe », ne
tient aucun compte de l’avis des habitants qui se mettent en colère,
distribuent 8 000 tracts, puis organisent une grande manifestation à Mende,
suivie, la même année, d’une manifestation avec barrage filtrant au col de Vielbougue.
En novembre 1994, la
contestation se durcit. Trois géologues sont expulsés du terrain où ils
réalisaient des sondages. On assiste à l’éclosion de dizaines de panneaux
hostiles au projet sur toute la commune, tandis qu’à Noël, l’association offre
un millier de voitures en modèle réduit au maire de Mende… Puisque l’humour ne
suffit pas, la pression est maintenue sur les équipes de sondage qui osent
encore fouler le sol de la commune. Même si les travaux de ces dernières sont
sans cesse interrompus, les Grézois estiment que des résultats ont été
obtenus : ils débarquent en force à la DDE de Mende et exigent que ces
résultats leur soient communiqués ! Frondeuse, l’association va jusqu’à
organiser sa propre enquête, dite « d’inutilité publique »…
Les accrochages sur le
terrain avec les représentants de la DDE se multiplient. À présent, c’est au
tour des géomètres d’opérer. Pris à parti par les opposants, ils appellent les
gendarmes à la rescousse, qui vont alors dresser un procès-verbal à la commune
pour obstruction à chantier public. Le maire de Grèzes répond par un
procès-verbal contre la DDE qui ne respecte pas son arrêté municipal
d’interdiction des chemins aux véhicules non agricoles ou forestiers. « On
n’avait jamais vu ça ! » s’exclame le géomètre expert. La DDE prend d’ailleurs
soin de changer chaque fois d’entreprise pour réaliser les mesures, à croire
que personne ne veut plus avoir affaire à ces acharnés de Grézois ! Les
derniers géomètres à avoir réussi à travailler ont mis en place des piquets et
peint le sol. Le lendemain, le maire lui-même suggère à ses administrés
d’enlever les piquets, et de multiplier les points de peinture blanche pour
brouiller les pistes.
L’Équipement tente de changer
de tracé pour éviter le « village de fous ». Pas de chance ! Chaque fois qu’il
veut passer quelque part, une nouvelle vague de résistance se soulève,
provoquant ainsi la création de l’association fédératrice Sauvons nos
villages ! La DDE explore d’autres moyens d’arriver à ses fins. Tandis qu’elle
remporte l’un de ses procès contre Grèzes, elle parvient à obtenir du préfet
qu’il classe en rouge la zone Natura 2000 – prévue sur la commune pour
protéger les chauves-souris –, ce qui signifie le rejet définitif du site pour
le classement, pour cause de « concertation impossible ». Aucun secours ne
pourra donc être attendu du côté de la Commission européenne en cas de
traversée du territoire par la 2 X 2‑voies.
En 1997, l’association est
reçue par le ministre des Transports Jean-Claude Gayssot, qui s’applique à
réconforter les villageois, mais dissimule mal une certaine sympathie pour le
projet. Peu après, les opposants profitent de l’organisation des Journées de
la Lozère à Paris pour s’inviter, et débouler avec leurs banderoles… L’année
suivante, l’enquête publique est lancée et recueille, évidemment, une très
forte participation des adhérents hostiles à l’infrastructure. S’ensuit une
nouvelle opération « dépique-nique », à l’issue de laquelle les géomètres
retrouveront en tas les piquets qu’ils avaient plantés la veille… Fin de la
consultation publique, la commission d’enquête émet son avis : il est
défavorable. La DDE se rétracte…
Victoire ? Pas encore. C’est
comme dans Astérix : on croit, à la fin de l’épisode, que les Romains ont
perdu et qu’ils ne reviendront plus. Or, l’épisode suivant, ils sont de
nouveau là, avec une idée encore plus saugrenue ! Cette fois‑là, la DDE décide
de ne pas attaquer directement. Elle organise son plan d’action le plus
discrètement possible, et frappe en retrait du village de Grèzes, sur un
portion réduite de la 2 X 2‑voies. C’est la technique de l’étau, bien connue
des société autoroutières. Ça bloque ici ? Alors on construit avant, on
construit après. Il n’y aura ensuite plus qu’à relier. Une nouvelle enquête
publique s’ouvre en juillet 2000, sur un tronçon difficile à défendre. Les
enquêteurs donnent un avis favorable. En janvier 2002, l’utilité publique est
déclarée sur le nouveau tronçon. L’association Non à la deuxième autoroute n’a
plus qu’une arme à sa disposition : le recours devant le Conseil d’État.
L’heure est grave. Tout espoir n’est pas perdu, mais les cœurs se serrent. Il
y a hélas ! fort à craindre que les villageois, face à la plus haute instance
administrative du pays, se feront balayer d’un revers de la main, et que la
DDE pourra poursuivre son plan étape après étape, jusqu’au succès total.
Réflexions de Jean-Paul
Thomas, maire de Grèzes :
« Nous avons beaucoup agit
pour diffuser l’information : stands sur les marchés, articles dans les
journaux locaux, tracts, et surtout panneaux le long des routes (très
important !). Malheureusement, nous n’avons pas su retenir l’attention des
grands journaux ou chaînes de télé nationales, ce qui fait que la
médiatisation s’est bornée au cadre régional. Pareil lorsque nous
communiquions avec d’autres associations : toutes étaient attachées à une
cause locale, et même la Fnaut ne nous a pas permis d’obtenir une meilleure
audience. Il est dommage qu’il n’existe pas de véritable association
fédératrice d’opposants aux autoroutes au niveau national.
Sans médias, sans réseau
associatif efficace, on sentait que notre sort ne dépendait que de nous-mêmes
et que nos perspectives de réussite dans le temps étaient fragiles. Pourtant,
nous avons fait tout ce qu’il nous semblait concevable de faire, en utilisant
le plus possible l’arme de l’humour. Nos litiges administratifs avec la DDE,
même s’ils ne se concluaient pas toujours par la réussite, étaient pour nous
très profitables, car ils faisaient notre publicité et montraient aux
adhérents qu’on se remuait. De plus, avec nous sans cesse sur son dos, la DDE
était beaucoup moins libre de ses actions…
Quand la DDE s’est retirée du
projet suite à l’avis défavorable émis par les commissaires-enquêteurs,
beaucoup d’entre nous ont cru la partie gagnée. À présent que la DDE est
revenue avec un dossier modifié qui cette fois a été entériné, nous n’avons
plus d’autres recours que le Conseil d’État. Mais l’action doit se poursuivre
sur le terrain. Si nous reculons maintenant, nous nous ferons avoir. Notre
combat durera tant que ce projet ne sera pas définitivement annulé.
L’association sera-t-elle amenée à organiser le blocus des chantiers ? Nous
n’en savons rien, mais cette perspective n’est pas à écarter. »
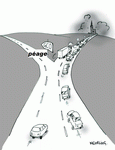
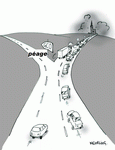
 le navigateur alternatif à Internet Explorer
le navigateur alternatif à Internet Explorer